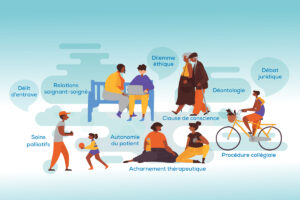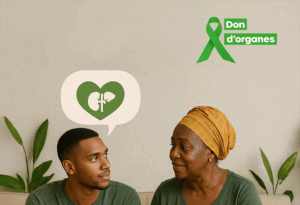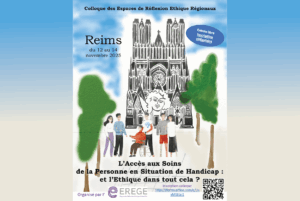Interrompue par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, la procédure législative d’un nouveau projet de loi sur la fin de vie a repris et s’apprête à être étudiée au Sénat. Entre respect des choix personnels et nécessité d’un cadre légal, cette réforme qui prévoit d’instituer un droit à l’aide à mourir, s’apparente à un véritable défi éthique aux enjeux complexes. Analyse.
Qu’est-ce la fin de vie ?
Selon le Code de la santé publique, la fin de vie désigne les moments qui précèdent le décès d’une personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ». À l’heure actuelle, les progrès de la Médecine sont tels qu’ils peuvent entraîner des situations de survie jugées indignes par certains. C’est pourquoi la fin de vie entre dans le champ des débats bioéthiques. En voulant légiférer sur cette question, le président de la République, Emmanuel Macron, répond à une demande sociétale de plus en plus forte.
Le projet de loi sur la fin de vie avait été initialement présenté en avril 2024, mais son examen avait été suspendu en raison de la dissolution de l’Assemblée Nationale et de l’organisation des élections législatives anticipées au mois de juillet. La procédure a repris sous le nouveau gouvernement au cours du 2ème trimestre 2025. Le texte a été adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale fin mai 2025 et devrait être examiné par le Sénat avant la fin de cette année.
Pourquoi la fin de vie soulève-t-elle d’importantes considérations éthiques ?
Le sujet de la fin de vie a une forte résonance éthique, car il touche à une thématique sensible, souvent jugée taboue, qui est celle de la mort, une notion philosophique et anthropologique majeure. Chez les soignants, l’interdiction morale et déontologique de donner la mort reste une norme forte. Mais elle se heurte à des dilemmes éthiques dans certaines situations de fin de vie, où se posent les limites du soulagement, le respect de l’autonomie du patient et plus largement, la question du droit à mourir dans la dignité.
La mort, nous y serons tous confrontés un jour. Alors chacun, personnel soignant ou non, est en droit de s’interroger : comment aborder la question de sa propre finitude et la question de la mort, quand la limite de la vie confronte aussi aux limites des savoirs et de la médecine ? Comment, dans une logique de soin, soigner et accompagner les personnes dans ce rapport à leur mort proche ou imminente ? Que faire face à un patient incapable de communiquer ses souhaits sur un moment et des décisions aussi intimes ?
Ces réflexions prennent aussi la forme de dilemmes qui agitent le débat public aujourd’hui, dans une société fortement marquée par la revendication d’autonomie : peut-on accorder à toute personne le contrôle absolu de sa vie et de sa mort, jusque dans un droit à l’euthanasie ou au suicide assisté ? Quelles valeurs peuvent manifester le respect de la dignité de la personne dans ces circonstances complexes qui posent la question du sens et des limites à franchir ou non ?
Pourquoi l’évolution de la législation est-elle envisagée ?
Pendant longtemps, la France est restée dans une position de statu quo. Elle s’est positionnée contre l’interdiction de l’obstination déraisonnable, en autorisant l’arrêt de traitements jugés excessifs, tout en se refusant d’aller jusqu’à un geste actif visant à provoquer ou accélérer la mort.
La distinction se résume de la façon suivante : il y avait un enjeu éthique fort à savoir laisser mourir, mais pas faire mourir. Les soins palliatifs étaient estimés suffisants pour répondre éthiquement, médicalement et fonctionnellement parlant à la plupart des demandes ou des besoins des personnes en fin de vie. En soulageant la douleur et en accompagnant ces personnes, les soins palliatifs peuvent, en effet, offrir une alternative acceptable aux demandes d’aide active à mourir. L’enjeu éthique, dans ces situations, ne serait pas ainsi d’ouvrir un nouveau droit, mais de garantir un droit effectif à bénéficier de soins palliatifs réels et de qualité.
Toutefois, sous l’effet des évolutions des situations cliniques notamment, les besoins ont changé et des limites sont apparues. Certaines personnes, dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, se retrouvent déjà dans des conditions de qualité de vie qui ne leur semblent plus supportables. Les dispositifs actuels de soins palliatifs, comme la sédation profonde et continue ou la possibilité d’arrêter les traitements, ne suffisent pas – un argument spécifiquement avancé par le comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans son avis n°139 sur la fin de vie (septembre 2022).
Le poids de la demande sociétale est aussi à prendre en compte, là où la revendication d’autonomie vient modifier la nature des relations de soin et le lien entre les patients, la société et le système de santé.
Pour autant, si l’autonomie et la liberté de choix des patients est reconnue et incontestée depuis 2002 et la Loi Kouchner, son extension sur le sujet de l’euthanasie ou du suicide assisté est plus complexe. Comment mesurer l’insuffisance d’un soin palliatif ou le degré d’intégrité ou d’éclairage réel d’une volonté de mourir ou de ne plus vivre ? Le sujet est d’autant plus complexe que le geste est définitif. Une fois la personne décédée, il n’y a plus de retour en arrière possible.
Il est donc très difficile de faire des choix politiques et juridiques sur des dilemmes éthiques aussi insolubles. Il n’y a pas une vérité, mais des choix à faire à un moment donné, dans une société, en l’état actuel de ses aspirations, de ses moyens et de ses représentations, et ces choix peuvent encore évoluer. La dimension citoyenne est donc très forte sur cette question de fin de vie.
En quoi est-ce important de consulter la population pour faire évoluer la loi ?
La manière d’aborder la fin de vie dépasse le seul cadre médical. C’est aussi, et avant tout, un sujet social, sociétal, culturel et anthropologique. La manière dont une population regarde la mort, et dont elle aborde l’accompagnement des personnes en fin de vie, est un vrai sujet de société. En tant que sujet politique, il y a donc une légitimité à pouvoir consulter les citoyens. La fin de vie est une question démocratique avant d’être une question médicale ou d’expertise.
Le caractère sensible du sujet (dilemmes forts et conflits de valeurs) impose le besoin d’avoir qualitativement l’éclairage de personnes non spécialistes, non engagées. Celles-ci vont apporter le point de vue des représentants de la société civile et permettre de « capter l’air du temps ». Un regard qui vient compléter celui des représentants politiques, des médecins et des usagers. Cela révèle d’autres savoirs, d’autres opinions qui vont permettre d’éclairer à 360° cette question complexe et surtout lui donner du sens.
Pour l’occasion, dès 2022, Emmanuel Macron a organisé une large consultation de la population : une convention citoyenne (184 Français tirés au sort) a été mise en place ainsi que l’organisation de débats et d’ateliers dans les territoires. Ces derniers ont été coordonnés par les espaces de réflexion éthique régionaux (ERER), avec la participation de membres du CESE (conseil économique social et environnemental) et du CCNE.
Quelle était la pertinence des espaces de réflexion éthique pour consulter la population ?
En tant qu’instances de référence au niveau régional, les espaces de réflexion éthique ont le plus de légitimité pour mener ces débats de proximité. Ils garantissent également une consultation réalisée dans le respect d’un certain cahier des charges, sur le plan éthique notamment : qualité des informations, neutralité et objectivité des débats, participations suffisamment plurielles, etc.
Entre réflexions et projet de loi : la chronologie
- Juin 2021 : le comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’auto-saisit du sujet de la fin de vie.
- 13 septembre 2022 : publication de l’avis n°139 du CCNE sur la fin de vie qui se dit favorable à « une aide active à mourir » strictement encadrée, à condition que soient parallèlement renforcés les soins palliatifs.
Septembre 2022 : le président de la République, Emmanuel Macron, exprime sa volonté d’ouvrir la France au débat sur l’aide active à mourir et annonce l’adoption d’un projet de loi courant 2024. Il répond ainsi à une demande sociétale et lance dans la foulée des concertations auprès des parlementaires et des professionnels.
- Octobre 2022 à mars 2023 : sous l’égide du CCNE (comité consultatif national d’éthique), les espaces de réflexion éthique régionaux (ERER) sont encouragés à organiser le plus de débats et rencontres possibles à destination du grand public.
- Décembre 2022 : une convention citoyenne sur la fin de vie est mise en place sous le pilotage du CESE (conseil économique, social et environnemental). Elle est constituée de 184 Français tirés au sort dans tous les départements français, chargés de proposer des pistes pour adapter le cadre d’accompagnement de la fin de vie.
- Avril 2023 : après s’être réunie à neuf reprises, la convention citoyenne a rendu ses propositions : 75 % de ses membres ont estimé que la loi Claeys-Leonetti ne répondait pas à toutes les situations. L’accès à une aide active à mourir a été préconisé, avec la nécessité de l’encadrer de conditions.
Publication par le CCNE et la CNERER (Conférence nationale des espaces de réflexion éthique) de la synthèse des 245 débats organisés par 14 ERER (de mai 2022 à avril 2023. Environ 40 000 participants, 12 villes concernées et 80 interventions réalisées par les members du CCNE. Les citoyens ont notamment souligné le role des aidants, la complexité du deuil et les situations des plus vulnérables (SDF).
- Mars 2024 : le gouvernement présente en conseil des ministres son projet de loi composé de deux volets : soins palliatifs et aide à mourir.
- Juin 2024 : la dissolution anticipée de l’Assemblée nationale interrompt l’examen du texte.
- Janvier 2025 : le gouvernement scinde le texte en deux propositions de loi (déposées en mars) : soins palliatifs et accompagnement / instauration d’un droit à l’aide à mourir.
- Du 12 au 27 mai 2025 : l’Assemblée nationale examine puis vote en première lecture les deux textes.
- 11 juin 2025 : vote solennel de l’assemblée avant transmission au Sénat.
Dernier trimestre 2025 : le Sénat devrait examiner les propositions avant un éventuel retour à l’Assemblée en 2026.
Fin de vie : 10 mois d’actions pour l’EREGIN
Afin d’optimiser la consultation populaire autour de la fin de vie, le CCNE avait chargé les espaces de réflexion éthique régionaux (ERER) d’organiser des débats sur les territoires.
Objectif : informer et débattre avec le plus grand nombre sur des thématiques variées comme les soins palliatifs, l’euthanasie, l’assistance au suicide, l’aide médicale à mourir, etc.
L’EREGIN, espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des Îles du Nord, s’était donc engagé à lancer localement des actions ciblées. Un comité de pilotage s’était constitué, pour l’occasion, regroupant les représentants de la conférence de la santé et de l’autonomie (CSA), de l’agence de santé (ARS), de France Assos Santé, du conseil territorial de santé de Saint-Martin, des membres de l’EREGIN, de la cellule de soutien éthique (CSE) et des professionnels de soins palliatifs (CHBT et CHU).
De février à novembre 2023, l’EREGIN a ainsi rassemblé le grand public, les jeunes, les personnes âgées et les professionnels de santé, lors d’une douzaine d’actions dans le cadre de cette campagne d’information et de concertation sur l’accompagnement à la fin de vie.
Au programme : enquêtes, ateliers, échanges, campagne d’affichage, émissions de télévision, conférences-débat, ciné-débat, débats publics et même plusieurs projections d’une pièce de théâtre conçue et filmée en Guadeloupe (Mes derniers souliers, écrite et mise en scène par Théo Dunoyer). Des rencontres ont également été organisées sur les Îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et à Marie-Galante.
Les recommandations du comité d’éthique
Les avis du CCNE ont pour vocation d’éclairer le débat citoyen, les pratiques des professionnels de santé et le législateur.
Dans celui consacré à la fin de vie (n°139), publié le 13 septembre 2022, le Comité a mis l’accent sur la conciliation de deux principaux fondamentaux : le devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles et le respect de l’autonomie de la personne.
Parmi ses recommandations figure l’importance et l’urgence de renforcer, en France, les mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs.
En cas de dépénalisation de l’aide active à mourir, le Comité recommande d’établir des repères éthiques, notamment en permettant un accès légal à l’assistance au suicide pour les adultes atteints de maladies graves et incurables, entraînant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, avec un pronostic vital engagé à moyen terme.
Selon lui, la demande devrait être formulée par une personne capable de prendre des décisions autonomes au moment de la demande, de manière libre, éclairée et répétée, et évaluée dans le cadre d’une procédure collégiale.
Le comité préconise également que le médecin chargé du patient ainsi que les autres professionnels de santé impliqués dans la procédure collégiale doivent pouvoir invoquer une clause de conscience.
À noter que huit des 45 membres du Comité ont exprimé des réserves concernant une éventuelle évolution législative sur la fin de vie.
Les grandes lignes du projet de loi
- L’ouverture d’un accès à « l’aide à mourir » sous conditions : être majeur, capable de discernement, être atteint d’une maladie incurable provoquant des souffrances que l’on ne peut soulager et entraînant un pronostic vital à court ou moyen terme. Si le malade est suffisamment autonome, ce sera à lui d’effectuer le geste final (suicide médicalement assisté). Dans le cas contraire, il pourra alors faire appel à un tiers pour l’y aider, proche ou personnel soignant. (euthanasie).
- Le texte garantit une clause de conscience aux soignants qui ne souhaitent pas concourir à l’acte, mais crée également un délit d’entrave à l’aide à mourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ce délit sanctionne les actes visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, notamment par des pressions morales, psychologiques ou physiques ou encore par la diffusion d’informations erronées sur les conséquences médicales de cette aide.
- Une stratégie décennale (2024-2034) pour prendre en charge la douleur et renforcer l’offre de soins palliatifs afin que tous les départements soient couverts. En effet, fin 2021, 21 départements ne disposaient d’aucune unité dédiée. L’État s’engage à investir un milliard d’euros supplémentaire (en plus des 1,6 milliard d’euros de dépenses annuelles).