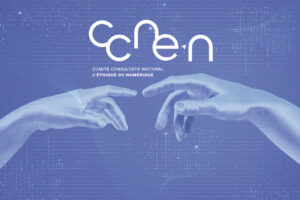Revendiquer ses choix, prendre des risques, décider de sa vie : des évidences pour la plupart, mais un défi lorsque l'on vit avec un handicap. Entre droits individuels, protection parentale et responsabilité professionnelle, l’autodétermination devient un terrain de tensions éthiques.
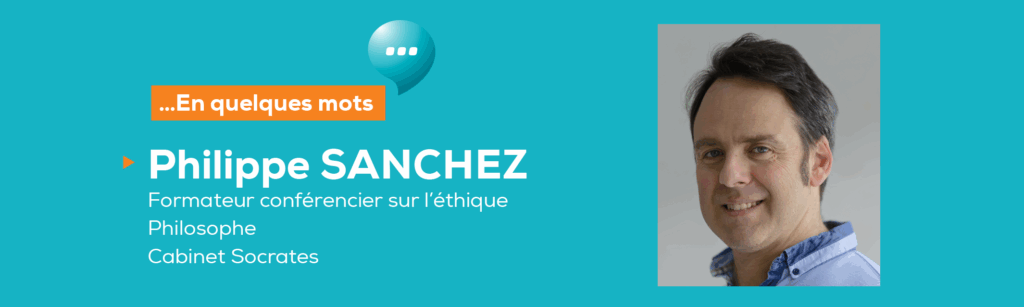
Eugénie a 20 ans et est accueillie dans un institut médico-éducatif (IME) depuis l’enfance. Elle vit avec une déficience mentale sévère et, même si elle ne parle pas avec des mots et des phrases structurées, elle parvient à se faire comprendre de ses proches et des professionnels qui l’accompagnent. À la majorité, elle a obtenu « l’amendement Creton » qui lui permet de rester à l’IME tant qu’elle n’a pas trouvé de place dans un foyer de vie. Eugénie manifeste régulièrement le souhait de rester le soir à l’internat de l’IME.
Les éducateurs de l’IME ont compris qu’il y avait là un projet exprimé par Eugénie, et ont organisé un stage de découverte de l’internat en accord avec sa mère, qui est tutrice de sa fille. Le stage a été bien vécu par la jeune femme, qui a souhaité poursuivre l’expérience. L’équipe éducative a donc proposé à la mère un hébergement pour sa fille à l’année, deux nuits par semaine à l’internat de l’IME. Or, la mère d’Eugénie a répondu qu’elle n’était pas prête à voir partir sa fille, et a refusé ce projet. Depuis le stage, lorsque le taxi vient chercher la jeune femme en fin d’après-midi, Eugénie crie, pleure, et parfois se roule par terre quand elle comprend qu’elle n’ira pas passer la nuit à l’internat de l’IME. Face au refus actuel de la mère et aux troubles récurrents de la jeune femme, les éducateurs sont en difficulté. Cette situation pose la question de l’accompagnement d’Eugénie à l’autodétermination.
L’autodétermination consiste à mener sa vie comme on l’entend en fonction de ses propres projets, en mesurant – autant que possible – les risques que l’on prend, et en mettant les moyens pour les réaliser. Dans le champ du handicap, la circulaire de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 mai 2017, relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées, requiert des professionnels du médico-social qu’ils travaillent l’autodétermination et le pouvoir d’agir des personnes handicapées.
Favoriser l’autodétermination et le pouvoir d’agir
Le pouvoir d’agir est la traduction du mot anglais empowerment, qui signifie développer nos actions autonomes en faisant fond sur nos capacités et nos compétences. Relevons cependant que la traduction de ce mot et son usage courant éludent la dimension politique du mot anglais. En effet, l’empowerment consiste à reprendre le pouvoir sur nos vies à ceux qui nous l’ont confisqué. En militant pour la cause des Noirs aux États-Unis, Martin Luther King Jr a travaillé à l’empowerment des populations afro-américaines pour faire valoir leurs droits. Travailler à l’empowerment des personnes handicapées signifie se battre, via des actions et des revendications politiques, pour le respect de leurs droits. Ce combat est notamment mené par l’association Nous aussi, dont le slogan est : « Rien pour nous sans nous. »
Comment travailler l’autodétermination et le pouvoir d’agir d’Eugénie ? La philosophie de l’autodétermination repose sur quatre champs à travailler. Premièrement, l’empowerment psychologique, c’est-à-dire la confiance en soi concernant ce dont nous sommes capables.
Deuxièmement, l’autonomie, comme disposition à faire des choix qui soient vraiment les siens, et non des choix dus à l’influence qu’exercent sur nous nos proches et les professionnels qui nous accompagnent. Troisièmement, la connaissance de soi qui nous permet de savoir – sur la durée – ce sur quoi nous savons agir, ce sur quoi nous avons besoin d’aide pour y arriver, et ce que nous ne savons pas faire pour l’instant ou définitivement. Quatrièmement, l’autorégulation qui consiste à savoir s’organiser, soit mettre en place les moyens pour mener nos projets, petits ou grands.
Les éducateurs ont travaillé l’autonomie d’Eugénie en cernant le souhait d’Eugénie de passer des nuits en dehors de chez elle. Ils ont ensuite aidé Eugénie à le faire valoir auprès de sa mère et tutrice, ce qui a débouché sur le stage de découverte. Mais le refus de donner suite à ce stage de la maman suscite un dilemme éthique pour les professionnels : ils doivent tout à la fois favoriser l’autodétermination et le pouvoir d’agir d’Eugénie (ainsi que le requièrent les politiques publiques du handicap) tout en travaillant avec et en soutien de sa famille.
Trouver ensemble les solutions
Néanmoins, le problème éthique est un peu différent pour la mère d’Eugénie. Comme tout parent d’un enfant, elle a à lui offrir les conditions de son émancipation. Mais quand votre enfant adulte est en situation de handicap, votre devoir de protection et de sécurité ne s’arrête pas le jour de ses 18 ans ! Le dilemme éthique de la mère est un grand classique, sur lequel buttent très souvent les professionnels de l’accompagnement, à l’instar des parents : liberté versus sécurité.
La théorie de l’autodétermination insiste sur « la dignité du risque » : une vie digne d’être vécue est une vie dans laquelle nous avons la possibilité de prendre des risques, aussi discernés et maîtrisés que possible. La mère met en avant la sécurité de sa fille – qui sera mieux chez elle, à domicile – mais est tout à fait lucide sur son propre blocage, puisqu’elle dit qu’elle n’est pas prête à voir Eugénie partir. Les problèmes éthiques des parents peuvent parfois être plus chargés d’émotions que ceux des professionnels, du fait d’une implication affective plus grande.
Dans cette situation, Eugénie ne peut pas faire valoir son droit à l’émancipation et au choix de son logement auprès de sa mère. Le rôle des professionnels de l’IME est donc central. Il passe par une écoute active, empathique de la mère, en s’adaptant à son rythme. Chercher à passer en force pour le bien d’Eugénie serait contraire à l’éthique du médico-social qui guide ces éducateurs. Notons pour finir que travailler l’autodétermination ne nécessite pas de travailler les quatre champs d’un coup. Selon les situations et leur évolution dans le temps et l’espace, il va falloir travailler un champ (ou plus) plutôt que les autres. Et l’autodétermination est graduelle : on peut être plus ou moins autodéterminé.
Les problèmes éthiques des personnes accompagnées, de leurs proches et/ou représentants légaux et des professionnels sont différents, mais souvent proches et ils s’interpénètrent. Chacun de ces acteurs a à gagner à échanger avec les autres sur ses dilemmes éthiques respectifs afin de trouver ensemble les solutions qui favorisent un juste équilibre entre sécurité et liberté.
- https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/files-spip/pdf circulaire_du_2_mai_2017_transformation_de_l_offre.pdf
- https://nous-aussi.fr/
- Voir la représentation en schéma des quatre composantes de l’autodétermination sur le blog hop’toys : https://www.bloghoptoys.fr/les-4-composantes-de-autodetermination
- Sur les enjeux majeurs des politiques publiques actuelles concernant le handicap et de la circulaire de la DGCS du 2 mai 2017, voir le passionnant rapport de Denis Piveteau, Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui change, février 2022 : https://www.info.gouv.fr/rapport/12713-rapport-de-denis-piveteau-experts-acteurs-ensemble-pour-une-societe-qui-change
- Voir la recommandation de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, L’accompagnement de la personne présentant un trouble du développement intellectuel (volet 1). Autodétermination, participation et citoyenneté, 2022, p. 33 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/02_tdi_rbpp_autodetermination.pdf
- Voir l’excellente synthèse de la théorie et de la pratique de l’autodétermination : Loïc Andrien & Coralie Sarrazin, Handicap, pour une révolution participative, Toulouse, éd. Erès, 2022, p. 73 et suivantes sur l’importance du risque dans la pratique de l’autodétermination.