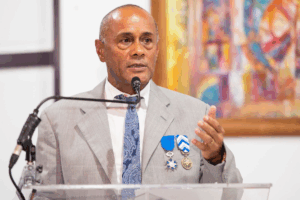Entre 2023 et 2024, Promotion Santé (ex IREPS, instance d’éducation et de promotion de la santé de Guadeloupe et des Îles du Nord) a mis en place une formation sur la santé mentale dans la relation d’aide et de soins. Objectif : développer les compétences en santé mentale des professionnels médico-psycho-sociaux, en faveur d’un accompagnement des personnes en souffrance psychique, dans leur parcours de vie et de soins sur le territoire de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Ce travail de longue haleine, mené en collaboration avec de nombreux partenaires et professionnels, s’est articulé autour de plusieurs modules. L’un d’eux, consacré au questionnement et la réflexion éthiques en santé mentale, a été confié à Mme Marie-Lise Salin-Hausswald et à M. Marc Bernos, psychologues cliniciens et membres du conseil d’orientation de l’espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des Îles du Nord depuis de nombreuses années.

« Faire au mieux dans le respect des personnes, de leurs droits, de leur autonomie et de leur dignité. »
En matière de santé mentale, les questions éthiques prennent une importance cruciale en raison de la vulnérabilité des patients. Dre Marie-Lise Salin, docteure en psychologie clinique, nous éclaire sur la nécessité d'une écoute attentive et d'une réflexion éthique collective pour accompagner au mieux les patients.
Les questions éthiques sont souvent exacerbées en santé mentale en raison de la nature des troubles mentaux qui peuvent affecter la capacité des patients à prendre des décisions éclairées. Comment aider les soignants sur cette problématique ?
Les troubles mentaux, tout comme les effets secondaires de certains traitements associés, peuvent, en effet, affecter les capacités de jugement, de discernement et par conséquent la disposition d’un patient à prendre des décisions éclairées.
Grâce à une démarche de réflexion éthique impulsée de manière collégiale, le soignant peut l’accompagner avec bienveillance et sans jamais lui dicter sa conduite. Le questionnement éthique, alimenté par des valeurs essentielles comme la bienfaisance et la justice, aide le patient à analyser sa situation avec un regard différent. Si je prends cette décision, quelles seront les conséquences ? Pour moi ? Pour ma famille ? Quelle mesure aura le moins d’impact négatif ? L’objectif est de l’aider à trouver la solution la plus juste possible.
Quelle est l'importance de la collaboration interdisciplinaire dans la résolution des dilemmes éthiques en santé mentale ?
Dans le domaine de l’éthique, la réflexion doit impérativement être collective. Un soignant seul va raisonner en fonction de son statut, de son identité professionnelle et de ses valeurs. Or, face à un dilemme éthique, comme les soins sous contrainte, il faut élargir le spectre de la réflexion pour aboutir à des choix ajustés et raisonnables résultant de l’étude des diverses possibilités évoquées lors de ces échanges interdisciplinaires. La réponse apportée doit être globale et faire consensus.
Par exemple, un psychiatre n’aura pas la même approche ni les mêmes arguments qu’une infirmière ou qu’une assistante sociale. Tous les différents points de vue exprimés sont à prendre en compte et permettent une progression dans la discussion.
Cette collaboration interdisciplinaire sous-entend toutefois une grande qualité de communication et d’écoute active dans une même direction. L’éthique en psychiatrie est avant tout une règle de conduite qui porte sur une offre de soins adaptée qui prend en compte le sujet malade dans sa globalité. L’éthique, c’est aussi un savoir-être qui amène tout professionnel de santé mentale à être dans une relation soignant-soigné de qualité. Cet état d’esprit ouvre le champ des possibles. La réflexion éthique au sein des établissements de santé mentale peut s’organiser et s’enrichir dans le cadre d’un comité d’éthique.
Quelles sont les principales considérations éthiques lorsque l’on travaille avec des populations vulnérables, comme les enfants ou les personnes âgées ?
Chaque individu a le droit fondamental d’accéder aux soins et d’être écouté dans ses désirs et ses besoins. Le consentement est une des considérations éthiques les plus essentielles. Cela implique une vigilance et une réelle écoute afin de préserver cette autonomie. Par exemple, dans le cas d’un bébé qui ne parle pas encore, les soignants observeront ses réactions, sa gestuelle, car c’est son corps qui va s’exprimer. Le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychique d’un enfant est primordial.
Autre valeur importante : celle de la liberté. Le dilemme éthique se pose en particulier lorsqu’elle s’oppose à l’intérêt collectif. Ce cas s’est très souvent posé lors de la crise sanitaire lorsque des patients en EHPAD*, par exemple, refusaient la vaccination tout en souhaitant conserver leur vie sociale, nécessaire à leur équilibre. Charge aux équipes de trouver les solutions intermédiaires les plus adaptées pour maintenir le bien-être de tous les individus.
Le troisième principe à respecter est celui d’équité. Enfant, bébé, personnes âgées dépendantes ou non… Les droits sont les mêmes, notamment dans l’accès aux soins et dans leur continuité, ainsi que dans la qualité de la prise en soins. Par exemple, les résidents d’un EHPAD ont les mêmes droits que les personnes âgées à domicile. Certaines structures l’oublient en limitant, voire entravant, certaines libertés comme celles d’avoir une vie affective et sexuelle.
Pour que le cadre des soins soit porteur, il est important d’y introduire un des fondements de l’éthique clinique, à savoir : entendre, respecter et comprendre la personne malade dans sa singularité et son intégrité.
*EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.